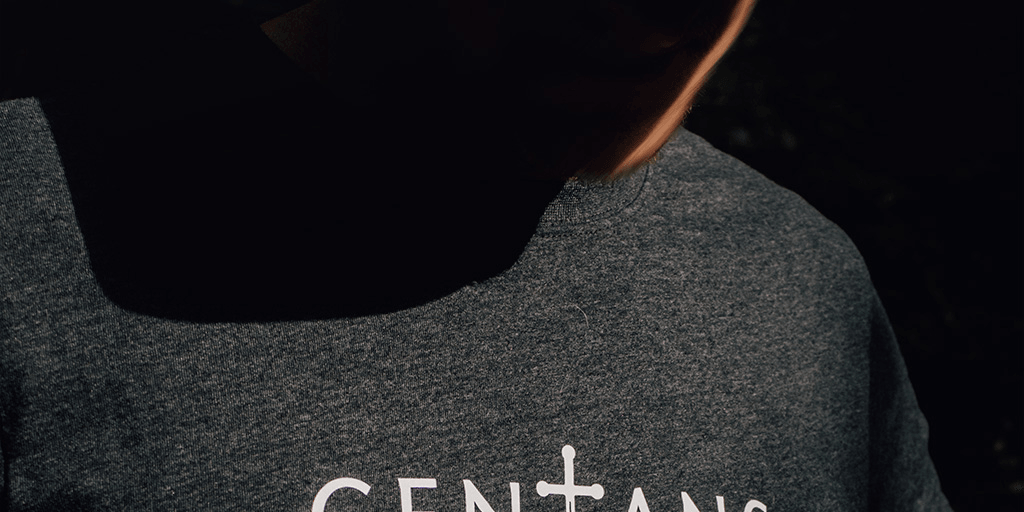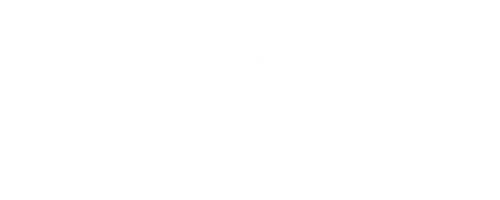Avril 2023. Le Soudan bascule de nouveau dans le chaos. En quelques heures, la capitale Khartoum devient le théâtre d’affrontements violents entre l’armée régulière soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).
Au milieu des combats : plusieurs centaines de ressortissants français, européens et étrangers, pris au piège. En moins de deux semaines, la France va mettre en œuvre l’une de ses opérations d’extraction les plus complexes de ces dernières années. Son nom : Opération Sagittaire.
15 avril, 9h20 : tout bascule
Le 15 avril, à 9h20 du matin, l’ambassadrice de France à Khartoum reçoit un appel : « La guerre a commencé, Madame l’ambassadrice. ».
Ce jour-là, les troupes du général Hemeti et les Forces armées soudanaises s’affrontent violemment en pleine ville. La capitale est coupée du monde, les communications se brouillent et les axes sont bloqués.
Face à l’urgence, la réaction française est immédiate. À Paris, le Centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) active sa cellule de crise. Une dizaine d’officiers y travaillent jour et nuit, représentant toutes les branches concernées, pour imaginer les scénarios d’évacuation possibles.
Le Centre de crise et de soutien du Quai d’Orsay se mobilise dans la foulée. Très vite, on commence à contacter les Français sur place par tous les canaux possibles : mail, SMS, messagerie instantanée. Le but est de savoir où ils sont, s’ils vont bien, s’ils peuvent tenir quelques jours. Chaque réponse permet de dresser une carte plus claire de la situation.
Dès les premières heures, la situation est jugée grave. L’idée d’une évacuation ne fait aucun doute. Mais encore faut-il choisir le bon mode d’action : par la mer via Port-Soudan (800 km de route), ou par les airs depuis un autre point que l’aéroport international, rendu inutilisable par les bombardements.
Découvrez pulls et sweats pour militaires.
Une force projetée en urgence
Dans les jours qui suivent, tout s’accélère. Le 18 avril, quatre avions quittent la France pour Djibouti, avec à leur bord du fret, des véhicules et des renforts : CPA10, GIGN, médecins militaires, diplomates.
En parallèle, la frégate multi-missions Lorraine reçoit l’ordre de se positionner vers le Soudan, tandis que l’état-major à Djibouti devient la plaque tournante de la coordination.
Le but est simple : gagner du temps, déployer rapidement un potentiel d’action et être prêts à intervenir dès que l’ordre politique tombera. Cet ordre sera donné quelques jours plus tard, par le président de la République, Emmanuel Macron, sur recommandation du chef d’état-major des armées.
Atterrissage à Wadi Seidna
La piste de l’aéroport international de Khartoum est criblée d’obus. Une alternative est identifiée à 20 km au nord : la base aérienne militaire de Wadi Seidna. Mais il faut l’accord des deux camps pour y poser un avion.
Les négociations sont longues, tendues. Le 22 avril, feu vert politique. Mais sur le terrain, les ordres peinent à circuler. Le risque que des soldats tirent sur un avion à l’atterrissage est réel.
Malgré tout, un C-130 français se pose de nuit, feux éteints, sur cette piste inconnue. Un acte fort et symbolique. La France devient la première nation à poser dans Khartoum en zone de guerre.
Les premières heures sont les plus importantes. Les commandos contactent les forces soudanaises sur place, installent un périmètre de sécurité, évaluent les capacités de la piste, déploient le module de chirurgie vitale. L’itinéraire vers la ville est validé : l’opération peut commencer.

Aller chercher les ressortissants
Les ressortissants sont dispersés. Certains se trouvent à l’ambassade, d’autres dans des résidences ou des villas privées. Les commandos doivent traverser la ville, parfois la ligne de front, pour aller les chercher. L’avancée se fait à tâtons, les cartes à la main, dans une ville coupée en deux par le Nil Blanc.
Le premier mouvement se déroule sans heurts. Mais dès l’aube, les combats reprennent. C’est dans cette phase que l’un des militaires français est gravement blessé par balle. Il est stabilisé au pied de l’avion, puis opéré immédiatement sur la base. Sans ce module chirurgical, sa vie aurait été perdue.
« Ce qui a fait la différence ce jour-là, c’est la réactivité de ses camarades et la robustesse du dispositif médical. » - général Philippe de Montenon, adjoint au chef du CPCO, lors de son interview sur Defcast du ministère des Armées.
Une évacuation rythmée et une logistique millimétrée
Une fois le contact établi et la piste validée, les allers-retours s’enchaînent. Avions, personnels médicaux, forces de sécurité, diplomates : chacun joue son rôle pour évacuer méthodiquement les ressortissants.
- Chaque vol est rempli à 100 %.
- Les priorités sont respectées : enfants, blessés, familles.
- L’identification se fait à la main, parfois avec des papiers griffonnés.
Les convois sont escortés, le rythme est tendu. Un deuxième convoi dirigé par des commandos traverse Khartoum. À chaque checkpoint, les soldats sont braqués. Un véhicule prend une balle dans le capot. Plus loin, un militaire tombe. Chaque évacuation est un combat.
La frégate Lorraine à Port-Soudan
Pendant que les évacuations aériennes se poursuivent, la frégate La Lorraine est envoyée à Port-Soudan. C’est la première fois qu’un bâtiment français jette l’ancre ici depuis 1996. Une centaine d’enfants, des familles entières et du personnel de l’ONU sont embarqués.
Jamais une frégate française n’avait évacué autant de civils en situation réelle. L’équipage, formé pour le combat, improvise avec humanité. Ils opèrent de nuit, traversent la mer Rouge et déposent les réfugiés à Djeddah, en Arabie Saoudite…
Un dernier effort à El Fasher
Dans l’ouest du pays, à El Fasher, un convoi onusien est bloqué. Le CPA10 (Commando parachutiste de l'air n°10), unité d'élite des forces spéciales de l'Armée de l'air spécialisée dans les opérations en milieu hostile, intervient une nouvelle fois.
En une heure, une centaine de personnes sont identifiées, sécurisées et extraites. Là encore, la réactivité du dispositif fait la différence.
Ce que l’on retient de l’opération Sagittaire
1 017 personnes évacuées. Dont 225 Français, et plus de 700 ressortissants de 84 nationalités. Un seul blessé, sauvé. Aucun décès. Une évacuation menée dans un milieu non permissif, avec une pression constante.
« On a de belles armées. Un système de commandement solide. Et une équipe France qui a tenu son rang. » – Général Philippe de Montenon
La France fut le premier pays à poser un avion à Khartoum. Elle a su conjuguer rapidité de décision politique, coordination stratégique, et excellence tactique sur le terrain.
L’efficacité de l’opération Sagittaire s’explique par plusieurs facteurs :
- La réactivité des forces prépositionnées à Djibouti a fait gagner un temps précieux.
- La coordination entre diplomatie et armée a permis une action fluide, sans friction.
- Et sur le terrain, les militaires ont agi avec calme, discipline et courage.